A l’inverse de la tradition portée par un John Rawls, Amartya Sen s’intéresse à l’idée d’une justice construite sur une assise véritablement démocratique, les théories du choix social .
La thèse essentielle de Sen est simple. Il établit un contraste entre deux conceptions de la justice. La vision traditionnelle plus paradigmatique, que Sen appelle l’institutionnalisme transcendantal, basée sur la théorie de la justice de John Rawls, est opposée à une approche comparative plus axée sur la réalisation, développée par de nombreux penseurs et adoptée par Sen lui-même.
La première repose sur un contrat social entre les individus qui évoluera ostensiblement dans une hypothétique « condition originelle » d’impartialité où chacun est libre de ses intérêts en raison d’un « voile d’ignorance » qui le sépare de ce qu’il sera dans le monde réel. Cette condition est alors censée conduire à deux principes fondamentaux de justice (liberté, égalité et équité) et déterminer les bonnes institutions et les règles régissant la justice, après quoi nous sommes chez nous et libres sur la voie de la justice parfaite. Selon ce dernier point de vue, Sen se demande si la justice parfaite est soit réalisable, soit nécessaire, et si la création d’institutions et de règles est suffisante pour que la justice soit réellement rendue dans le monde réel.
La réponse est évidemment négative. La plupart du temps, nous ne nous intéressons pas à ce qu’est une justice parfaite ou idéale dans une situation donnée ; nous avons surtout deux ou plusieurs options que nous devons évaluer pour voir laquelle serait plus juste. Cette évaluation doit se fonder sur un raisonnement, de préférence public, ouvert, impartial et démocratique, qui mène aux meilleurs choix sociaux et à la réalisation effective de la justice entre les personnes dans le monde réel.
livre d’occasion en très bon état***
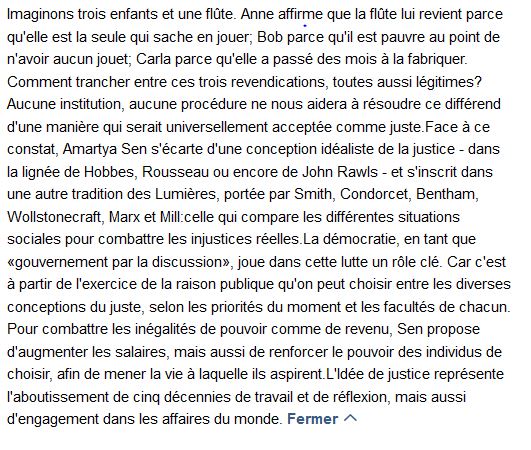
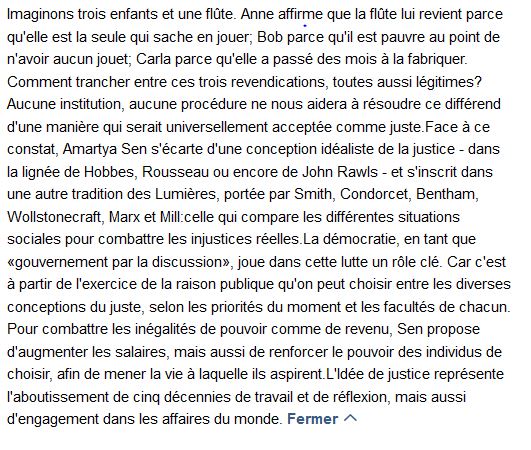
livre –
une autre philosophie de la justice revitalisée par Amartya Sen